 Guillaume Bénier
Guillaume Bénier
Architecte, Maître de Conférences Champ TPCAU à l’école d’architecture de Saint-Etienne et membre du Groupe de Recherche en Formation (GRF) «Transformations»
Je souhaite exposer ici succinctement ma compréhension du programme du laboratoire de recherche et de cette instance, mon expérience pédagogique, les raisons pour lesquelles je candidate.
Compréhension du programme du GRF «Transformations»
Les ateliers de recherche au sein du laboratoire de recherche sont portés par une équipe pédagogique pluridisciplinaire. Le travail s’intéresse aux pratiques architecturales et urbaines qui participent à la transformation du cadre bâti, enrichie des champs « connexes » indispensables à la formation des étudiants
et à la compréhension de notre environnement. Les pratiques architecturales et urbaines sont appréhendées au sein du laboratoire de recherche tant dans leurs dimensions sociales, techniques, créatives, artistiques que dans les processus de production d’espaces bâtis. La transformation et la résilience des territoires, marqués par d’anciennes formes et pratiques industrielles, agraires, artisanales, aujourd’hui en crises, sont également questionnés.
La situation géographique, l’histoire du développement, la singularité de la ville et du territoire de Saint-Etienne ont naturellement amené l’école à travailler sur les territoires post-industriels, péri-urbains et ruraux. Face à des territoires en difficulté, quelle stratégie et action définir?
Les activités menées au sein du GRF croisent 3 thèmes génériques dans une approche transversale au sein de 3 ateliers thématiques:
- Habiter : Architectures, Crises, Engagements aborde la question de l’habitat et celle des conditions de sa conception et production. Il revendique une architecture « d’intérêt public » et interroge la responsabilité et la légitimité de l’architecture et de l’architecte.
- Faire forme : Architectures – Matérialités – Expérience propose une approche critique qui interroge les formes contemporaines par l’appréhension de l’architecture autant par ses mises en forme que par ses mises en oeuvre
- Écologie : Architectures, Climat, Technique se consacre aux multiples problématiques liées au changement climatique, aux enjeux environnementaux, et à la place du vivant dans la conception et la production du cadre bâti.
Expérience pédagogique en écho avec la recherche
Dans la formation initiale où j’enseigne actuellement, nous proposons et revendiquons, au sein de l’atelier de projet de Licence 3, et en lien avec le champ Ville & Territoire, une approche multi-scalaire du projet et une réflexion autour de la notion de « l’habiter » qui trouve son aboutissement dans le projet d’édifice.
De la même manière, le séminaire de Master « Ressources Latentes » que nous engageons cette année avec F. Bonnet et G-H Laffont aborde et croise les 3 thèmes génériques présentés ci-avant qui bien entendu ne sont pas étanches.
Enfin, l’encadrement du travail de mémoire en cycle master que j’effectue depuis maintenant 2 ans, sous un autre format que celui de l’atelier, en lien étroit avec les champs connexes (histoire, sociologie, technique et arts plastiques…), amène les étudiants à interroger ces thématiques et de développer un travail plus approfondi d’initiation recherche.
Si la commission recherche doit formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives aux orientations et à l’organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats, préparer et proposer des mesures relatives à l’organisation et à l’évaluation des unités de recherche, elle doit articuler dans son projet de pédagogique recherche et formation, promouvoir et développer des activités de diffusion de la culture scientifique.
Proposition de candidature
Je revendique une inscription de la pédagogie et des actions de recherche dans le contexte local,académique et non-académique. Cet ancrage représente une des caractéristiques du GRF Transformations comme l’a souligné d’ailleurs le rapport de l’HCERES.
Cela présuppose de connaître le territoire, d’identifier les ressources et de s’appuyer sur les acteurs existants. Les ateliers de projet en cycle Licence (partenariats réalisés avec les villes de Roanne, Montbrison par exemple) ont permis une lecture et compréhension du territoire, et pour les étudiants, des premiers
échanges avec élus.
Il me paraît indispensable de favoriser le format des recherches actions, comme celles que nous réalisons avec la DDT 42 cette année, afin d’articuler théorie et pratique, et pour l’école de faire valoir son savoir-faire et expertise pour les sujets qui nous préoccupent. Le travail que je mène autour de la valorisation du patrimoine industriel avec Pays et Ville d’Art et d’Histoire sous la forme de publications et de visites à destination du grand public est un autre exemple d’action locale.
En l’absence de CAUE dans le département de la Loire, un travail de valorisation et de diffusion de la culture architecturale auprès du grand public est une mission de l’école que j’entends articuler avec le laboratoire de recherche.
A titre d’exemple, les manifestations que nous avons réalisé avec J. Auroux dans le Cadre Programme Egalité des Chances, pour les Journées Européennes du Patrimoines ou les Journées Nationales de l’Architecture avec le site Le Corbusier de Firminy nous a permis de mettre en contact l’architecture et le public, et, avecles étudiants de parler d’architecture.
Voici les réflexions que j’entends proposer à la commission recherche, en lien avec mes différents collègues.
 Maria-Anita Palumbo
Maria-Anita Palumbo
Anthropologue, maîtresse de conférences en SHS à l’ENSASE
C’est en tant que enseignante-chercheuse de cette école, membre du GRF Architecture et Transformations, Maitre de Conférence en sciences humaines et sociales pour l’architecture et docteur en anthropologie que je porte ma candidature aux très prochaines élections pour le siège vacant à la Commission Recherche de l’ENSASE.
Cette candidature, méditée, est motivée par l’élan de transformation que nous vivons depuis quelque mois à l’ENSASE: après deux ans de travail afin de mettre au point le nouveau programme pédagogique, et au vu des changements plus récents dans des postes clefs du fonctionnement d’un équipement public du MCC qu’est une école d’architecture, il est pour moi évidant que c’est un nouveau projet d’école qui est en élaboration.
Bien définir la place de le la recherche et ses objectifs au sain de ce projet est fondamentale. En effet, une école d’architecture est un lieu de formation de futurs
architectes mais aussi de jeunes citoyens et citoyennes, formation qui doit être assurée non seulement grâce à la richesse d’un programme pédagogique, mais aussi par une dynamique de recherche qui garantie l’élaboration d’un savoir critique et réflexif en prise avec la société et les questions contemporaines qui interpellent et impactent les architectes et l’architecture. Je souhaite donc pouvoir me joindre au travail déjà en cours et porté avec énergie par
mes collègues de la Commission Recherche afin de renforcer les orientations stratégiques de l’École en matière de recherche et de diffusion des savoirs liés à l’architecture et à la ville afin que l’Ensase assume avec intelligence le fait d’être un milieu de production et de diffusion de savoir, avec ses spécificité et ses besoins, qu’elle doit pouvoir, à la fois, faire valoir auprès de ses partenaires territoriaux (universitaires, associatifs, entrepreneuriaux…) et valoriser à échelle internationale.
Être candidate à cette élection signifie pour moi enrichir la composition existante de la CR avec les compétences d’une enseignante-chercheuse travaillant depuis plus que quinze ans dans des écoles d’architecture française et dans leurs laboratoires de recherche, à cheval entre sciences humaines et architecture, avec une expérience solide dans l’articulation recherche-pédagogie et un parcours de recherche à échelle internationale.
 Luc Pecquet
Luc Pecquet
ethnologue, maître de conférences en SHS à l’ENSASE. Il est membre du GRF Architecture et Transformations de l’ENSASE
Il défend notamment l’idée que “les thématiques de recherche doivent rester libres, et que les partenariats doivent être ouverts, par delà les seules questions de « territoire », qui sont souvent revenues ces dernières années“.
Par ailleurs, investi dans le Projet national terre crue, il souhaite tenter de lancer des dynamiques de recherche
et/ou de questionnement traitant de cette thématique au sein de l’École.
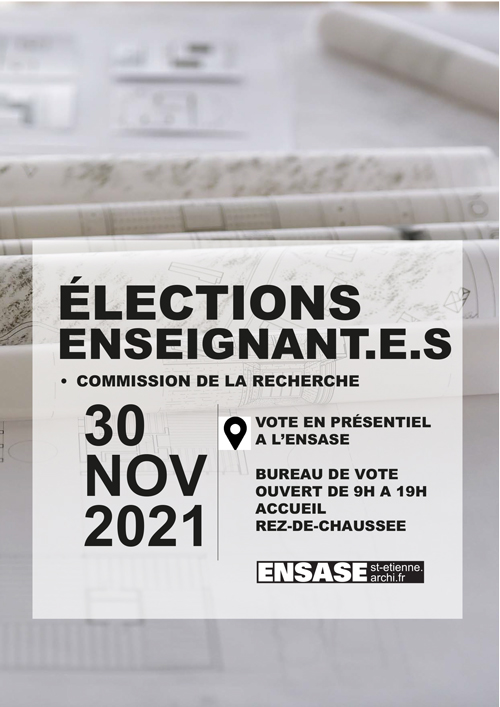

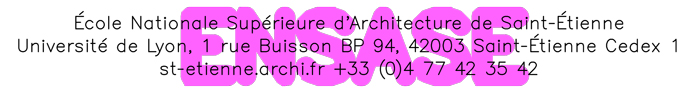
 Guillaume Bénier
Guillaume Bénier Maria-Anita Palumbo
Maria-Anita Palumbo Luc Pecquet
Luc Pecquet